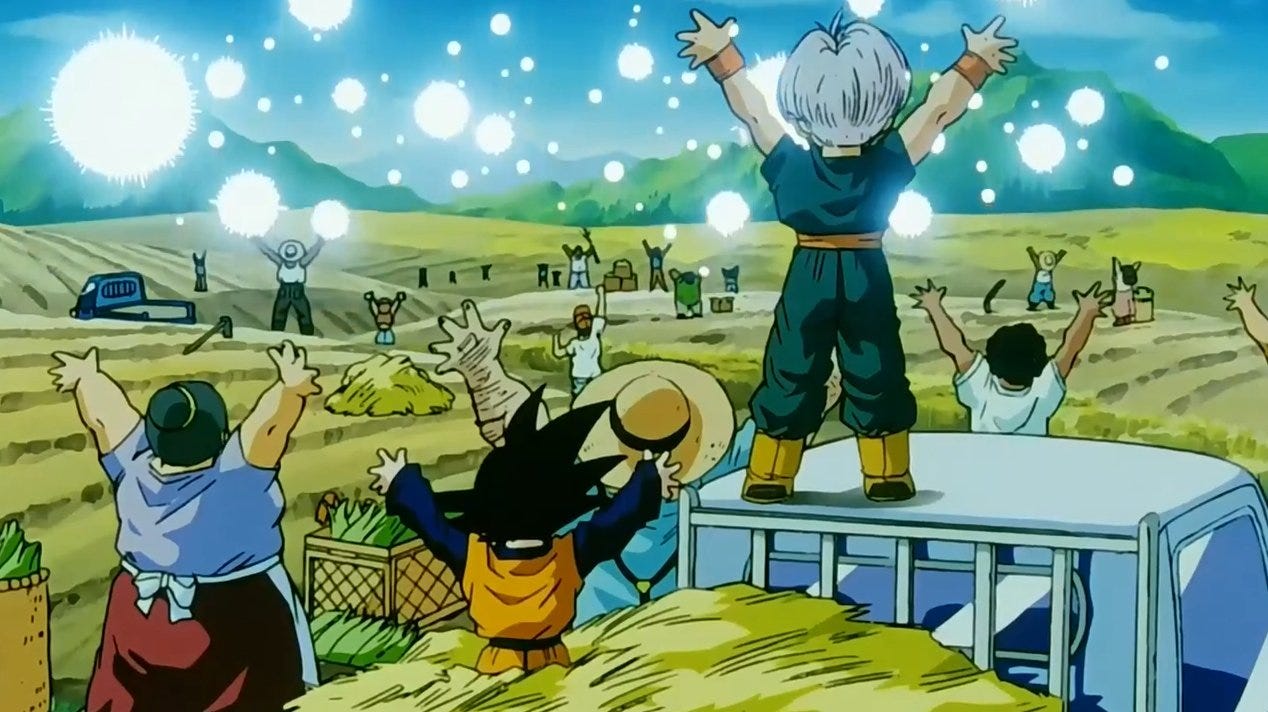Ce qui ne peut être copié
genki dama
Il y a un an, l'aventure start-up a commencé. Pas par ambition, mais parce qu’une opportunité s’est présentée. Difficile de passer à côté sans regretter.
Tout a démarré dans une chambre, en expérimentant. "Merlin" est né et s’est classé 5ᵉ mondial parmi les LLMs de sa taille. Des messages sont arrivés, une citation dans un papier de recherche pour un jeu de données... mais aucune idée claire de la suite. Comment transformer tout ça en produit ? Comment le commercialiser ?
Rapidement, une idée s'est imposée : le vrai enjeu n'est pas de chercher à scaler immédiatement, mais de comprendre ce qui ne peut pas s'industrialiser.
Seul, mais prêt à relever le défi, l’objectif était de créer quelque chose de significatif. L’acceptation à la deuxième partie du Fighters Program (taux de 7,5 %) a renforcé cette ambition. Discussions à tout-va, exploration des tendances, observation du marché américain – souvent en avance de six mois sur l’Europe.
L'idée initiale : "fine-tuning as a service", la création de modèles d’IA générative sur mesure. Mais trop tôt ou mal formulée. Personne n’en avait besoin. Pourquoi gérer un modèle quand ChatGPT fait déjà le boulot ?
Les échanges se faisaient principalement avec des start-upers, souvent sans budget. Un besoin réel aurait poussé à l'internalisation du service. D’ailleurs, plusieurs tentatives de recrutement ont eu lieu. Mais sans véritable cas d’usage métier, impossible de justifier l’existence du projet.
Alors, pivot. Mais cette fois, en prenant le temps.
Car il ne s’agissait pas de construire quelque chose sans mission, sans envie de se lever le matin. Peut-être une raison pour laquelle la fortune ne s’est pas encore manifestée.
Retour aux fondamentaux : qu’est-ce qu’une start-up ? Paul Graham et son essai "Do things that don’t scale". Une phrase qui résonne.
Un exemple simple : le conseil ne se transfère pas, "réparer un lavabo" ne peut pas être produit en masse, créer son ordinateur dans son garage... Chaque situation est unique, ancrée dans un contexte précis, impossible à répliquer en série.
C’est en réalisant des choses non réplicables qu’on perçoit le moment où elles commencent à l’être. À condition d’être attentif.
Ce raisonnement ne concerne pas seulement les start-ups. Il s’étend bien au-delà. Je l’ai vu de mes propres yeux en testant différentes idées. À chaque pivot, la question revenait : est-ce que ça peut être industrialisé ? Est-ce que ça peut être automatisé ? Si oui, alors ce n’est pas un différenciateur. Si non, alors c’est soit une niche, soit un avantage durable. Cette tension entre 'scalabilité' et 'différenciation' est devenue une grille de lecture universelle.
Les pivots ont continué, encore et encore. Parfois choisis, parfois imposés.
D'abord suite a une demande, une offre d'extraction sous forme de graphique, d'un document texte. Permettant de visualiser les connections en un instant. Fun pendant un moment, mais pas suffisamment pour que j'y reste accroché.
Puis les agents, tendance du moment (juin 2024). Un marché vierge en France, mais déjà saturé ailleurs. Car derrière chaque nouvelle hype, c’est la même mécanique : industrialiser des tâches autrefois humaines. Ces agents permettent d’automatiser ce qui était artisanal. Mais encore une fois, sans besoin clair, sans vraie différenciation. Ces agents font tout et rien a la fois.
C’est l’illusion du 'scale first'. Créer une technologie puissante ne suffit pas si elle n’a pas d’ancrage dans le réel. Une innovation qui ne s’appuie sur aucun besoin métier profond est vouée à devenir un gadget. Et plus une technologie est standardisée, plus elle devient une commodité, donc sans valeur.
Mais encore une fois, pas de réelle besoin. De cette initiative sort quand même Gollm (initialement goal) qui a obtenu un petit succès.
Mais une chose n’a pas changé : ce qui compte, ce sont les choses qui ne se reproduisent pas en série. Celles qui demandent du temps, de l’attention. Les logiciels s’automatisent, les process s’industrialisent. Ce qui reste, c’est ce qui ne peut pas être copié.
Un client ne s’industrialise pas. Une relation ne se scale pas. Un insight ne sort pas d’un algorithme. OpenAI ne vaut pas pour son logiciel, mais pour son infrastructure, ses connexions, ses recrutements, la force qu’il a mise dans ce qui ne s’accélère pas.
Là est le vrai différenciateur. Là est l’opportunité.
Faire des choses qui ne scale pas n’est pas une fin en soi, mais une nécessité pour trouver ce qui, ensuite, pourra l’être.
Depuis que j’ai quitté le monde entrepreneurial pour un job plus stable, je vois de plus en plus de choses s’automatiser.
La valeur de certains actes s’évapore. Tout finit par être industrialisé, c’est juste une question de temps. On est encore à ce stade de **"do things that don’t scale"**, mais cette fois à l’échelle d’un système entier.
Chaque métier, chaque compétence suit le même chemin. C’est un rouleau compresseur. Ce qui faisait la force d’une expertise devient une API. Ce qui demandait un savoir-faire devient une feature. Ce qui nécessitait une relation humaine devient un chatbot. À ce rythme, tout ce qui peut être optimisé le sera. Ce qui semble intouchable aujourd’hui ne le sera plus demain.
Un naturel optimiste dans un monde qui s’accélère. Un changement de paradigme.
Ce n’est pas une fatalité. C’est une opportunité. À mesure que tout se standardise, ce qui échappe à l’industrialisation prend de la valeur. C’est là qu’il faut être. Pas dans ce qui se scale, mais dans ce qui ne peut pas être copié. Dans les liens humains. Dans l’intuition. Dans l’inattendu. C’est là que tout se joue.
Il ne s’agit pas juste d’observer ces transformations, mais d’y répondre intelligemment. La question n’est plus : 'comment automatiser ?' mais 'que reste-t-il d’inimitable ?'. C’est là que se trouve la vraie valeur.